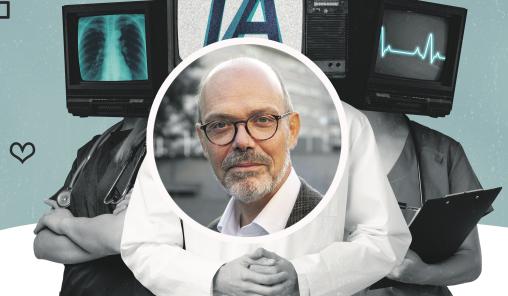Le taux d’absence élevé en Ville de Genève résulte de l’articulation complexe entre les différents corps d’intervention, du statut de la fonction et de la pénibilité de la tâche.
Entre police de proximité, police municipale, police cantonale et gendarmerie, la République y perd-elle son latin? Et les Genevois parviennent-ils à saisir les contours des prérogatives relevant des différents corps? Pas dit. Pire, cette multiplication des genres, brouillant les cartes des hommes de terrain communal, est-elle à l’origine du taux d’absence élevé au sein de certaines de ces polices municipales? Évalué à 13,5% par les autorités de la Ville de Genève, l’absentéisme s’explique également par la pénibilité du travail, un facteur que d’autres éléments tendent encore à aggraver.
Comme l’explique le Syndicat des polices municipales genevoises (SPMG): «Nous intervenons parfois en flagrant délit sans disposer ni de l’équipement adéquat, ni de la formation nécessaire. Concrètement, nous pouvons être appelés pour un simple tapage et une fois sur place, nous retrouver face à un individu armé. Comment sommes-nous censés réagir? Certes, ce type d’interventions est du ressort de la police cantonale. Toutefois, lorsque nous sommes réquisitionnés, nous ignorons ce qui nous attend sur le terrain. Et puis, lors d’une agression, devrions-nous attendre l’arrivée de la gendarmerie (déjà sur de multiples fronts) pour des raisons de sécurité? Et, il en est de même pour les cambriolages et les vols. Pourtant, nous arrivons la plupart du temps à interpeller les protagonistes malgré le danger.»
Alors, faut-il armer les policiers municipaux? Pour les représentants du corps municipal, cela va de soi. Mais en amont se pose le problème crucial de la formation. Et c’est là que le bât blesse. Contrairement à leurs homologues suisses (certains avec un cahier des charges plus restreint), les Genevois n’ont pas accès au brevet fédéral de policier. Pourtant, toujours selon le SPMG, cela leur ouvrirait de nombreuses portes sans pour autant grever lourdement les finances publiques. «Nous suivons déjà une formation de huit mois. Il ne manquerait que quelques modules pour être éligibles au brevet. Sans compter que ce sésame nous permettrait d’accéder à des postes à responsabilités aujourd’hui souvent confiés à des policiers brevetés. En outre, une formation uniformisée offrirait plus de mobilité entre canton et communes, comme le dispose la Loi fédérale sur le marché intérieur.» Validée par le Tribunal fédéral (TF), une procédure de reconnaissance est pendante auprès du Secrétariat à la formation, à la recherche et à l’innovation.
Pouvoir centralisé
Et ce n’est pas tout, selon le syndicat, la création d’un pouvoir centralisé, rattachant l’ensemble des polices municipales à l’Association des communes genevoises (ACG), constituerait une avancée majeure en matière d’organisation. «Une telle structure apporterait plus de clarté et de cohérence dans la gestion des effectifs. Elle faciliterait aussi une meilleure répartition des ressources humaines selon les besoins réels du terrain. Certains jeunes agents, aujourd’hui affectés à des communes relativement calmes, aimeraient être déployés dans des zones plus actives. Cela créerait une dynamique positive et une plus grande motivation au sein des équipes.»
Parmi les obstacles qui entravent l’action des agents figure également l’usage des feux bleus prioritaires. Dans certaines situations d’urgence, les agents se retrouvent confrontés à un dilemme: circuler à une vitesse supérieure à celle autorisée et s’exposer à des sanctions pénale et administrative ou porter secours à une personne en danger? «Le risque est que d’aucuns n’osent agir pour éviter tout problème. Notre demande, concernant cette problématique, adressée au Département des institutions et du numérique a été refusée.
«Nous avons fait recours auprès du TF, mais nous avons été déboutés car nous n’avions pas la qualité pour agir. Seuls les agents pouvaient former un tel recours à titre personnel», déplore le syndicat. Depuis un projet de loi a été déposé au Grand Conseil.
La profession a, ces dix dernières années, significativement évolué en raison de modifications législatives successives. Désormais elle a toute compétence s’agissant de l’application de la loi sur la circulation routière. Elle a aussi acquis certaines compétences judiciaires. Elle peut ainsi effectuer des perquisitions, accompagnée de gendarmes (puisqu’elle n’est pas armée). Elle arrête et auditionne les prévenus avant de passer la main à un commissaire. En matière de stupéfiants, elle intervient auprès de consommateurs et procéde à la saisie des substances. Si la quantité de drogue n’excède pas un certain poids, ils traitent la procédure. Au-delà de cette limite, l’affaire doit être transférée à la police cantonale. Et une situation que le SPMG juge aberrante? «La Loi nous enjoint de saisir des armes alors même que nous ne sommes pas autorisés à en porter. »
Centrale d’engagement unique
Le SMPG plaide enfin pour le regroupement de tous les appels d’urgence sous une seule centrale d’engagement. Cela représenterait un gain en efficacité ainsi qu’au niveau de la répartition des ressources humaines et matérielles. Actuellement deux centrales coexistent, l’une pour la police cantonale, l’autre pour la Ville de Genève. Dans certains cas, cette dernière est contrainte de relayer les appels à la centrale cantonale, ce qui engendre des pertes de temps et d’information. «Les agents de la Ville de Genève sont réguli